| Numéro |
Biologie Aujourd’hui
Volume 216, Numéro 1-2, 2022
|
|
|---|---|---|
| Page(s) | 1 - 6 | |
| DOI | https://doi.org/10.1051/jbio/2022006 | |
| Publié en ligne | 25 juillet 2022 | |
Article
La découverte de l’insuline 1921–1922 : un saut dans la recherche biomédicale
Institut de la Vision, Sorbonne Université, INSERM U968, 17 rue Moreau, 75012 Paris, France
* Auteur correspondant: william.rostene@inserm.fr
Reçu :
17
Janvier
2022
Si les symptômes du diabète ont été décrits depuis l’Antiquité et caractérisés par la présence de sucre dans les urines et une soif intense, ce n’est qu’à la fin du xixe siècle que les travaux de plusieurs équipes aboutissent à rechercher la substance active de la sécrétion interne du pancréas dans des extraits susceptibles de diminuer le glucose dans le sang et les urines chez le chien diabétique. C’est à l’Université de Toronto, au Canada, il y a 100 ans, entre 1921 et 1922, que Frederick Banting, Charles Best et James Collip, travaillant dans le département de physiologie dirigé par John MacLeod, obtiennent des extraits pancréatiques suffisamment purifiés qui permettent de traiter de jeunes patients diabétiques. Cette découverte de l’insuline est très vite reconnue et saluée par l’attribution du Prix Nobel de Physiologie ou Médecine en 1923 à Frederick Banting et John MacLeod. Cette découverte a eu d’importantes retombées scientifiques, industrielles et cliniques, toujours d’actualité.
Abstract
Discovery of insulin. If the symptoms of diabetes have been known since Antiquity, it is at the end of the 19th century that several investigators searched for the active substance of the pancreas and endeavoured to produce extracts that lowered blood and urine glucose and decreased polyuria in pancreatectomized dogs. The breakthrough came 100 years ago when the team of Frederick Banting, Charles Best and James Collip, working in the Department of Physiology, headed by John MacLeod at the University of Toronto, managed to obtain pancreatic extracts that could be used to treat patients and rescue them from the edge of death by starvation, the only treatment then available. This achievement was quickly recognized by the Nobel Prize in Physiology or Medicine to Banting and MacLeod in 1923. The discovery has had important scientific, industrial and clinical developments still efficient nowadays.
Mots clés : diabète / insuline / pancréas / Prix Nobel / retombées cliniques
Key words: diabetes / insulin / pancreas / Nobel Prize / clinical development
© Société de Biologie, 2022
Historique
Si le diabète, caractérisé par la présence de sucre dans les urines et une soif intense, a été décrit dans tous les manuscrits médicaux depuis l'Antiquité, ce n'est qu’à la fin du xixe siècle que plusieurs chercheurs établissent un lien entre cette maladie et le pancréas. En 1855, Claude Bernard décrit dans les Comptes rendus de la Société de Biologie le rôle du foie qui met le glucose en réserve sous forme de glycogène et peut le retransformer en glucose (Bernard, 1867). En 1869, l’étudiant en médecine allemand Paul Langerhans découvre que le pancréas contient, à côté des cellules sécrétant le suc pancréatique, d’autres cellules, regroupées en îlots. Ces cellules porteront son nom: les îlots de Langerhans (Laguesse, 1893).
Il faut attendre 1889 pour que l’expérience princeps soit réalisée à Strasbourg par deux médecins allemands, Josef Von Mering et Oskar Minkowski, montrant le lien entre pancréas et diabète sucré. Ils observent que l’ablation du pancréas chez un chien provoque le diabète sucré et qu’en lui regreffant un morceau de pancréas, la glycosurie disparaît. Ils en déduisent donc que le pancréas contient une substance capable de diminuer la concentration élevée de glucose chez les diabétiques (Von Mering & Minkowski, 1889). Cependant, ils ne savent pas précisément quelles cellules produisent cette substance. Ce n’est qu’en 1893 qu’un professeur à la Faculté de Médecine de Lille, Édouard Laguesse, suggère que les îlots de Langerhans sont responsables de cette « sécrétion interne » du pancréas, qui, en se déversant dans le sang, pourrait réguler la concentration de glucose dans les urines et le sang. Il utilise le terme « endocrine » pour qualifier cette sécrétion interne. Le mot « insuline » apparaît, quant à lui, pour la première fois en 1909 pour nommer la substance libérée par les îlots de Langerhans, par un physiologiste belge, Jean De Meyer.
À partir de ces premiers travaux, la recherche sur la substance interne du pancréas va prendre de l’ampleur. Plusieurs chercheurs sont ainsi proches de la découverte au début du xxe siècle, soit parce qu’ils réussissent à obtenir des extraits pancréatiques capables de diminuer le glucose soit qu’ils tentent des expériences chez l’homme. Parmi eux, on peut citer un Français comme Eugène Gley (1922), un Allemand comme George Zuelzer (1912), des Américains, Ernest Scott (1912), Israël Kleiner (1919) ou John Raymond Murlin (Murlin et al., 1923), le découvreur de l’autre hormone pancréatique, le glucagon, et un Roumain, Nicolas Paulesco, qui a travaillé à Paris dans le laboratoire du diabétologue Etienne Lancereaux (Paulesco, 1921) (Figure 1). Lors de la séance de la Société de biologie du 23 décembre 1922, Eugène Gley demande l’ouverture d’un pli cacheté qu’il avait adressé en février 1905 et qui présentait, comme nous le verrons plus tard, des résultats analogues à ceux du groupe de Toronto (Figure 2).
Mais parce que leurs extraits n’étaient assez purifiés et que les effets restaient faibles et accompagnés d’importants effets secondaires, leurs préparations ne permettaient pas leur utilisation dans des essais cliniques.
On voit ainsi que, comme toute découverte, celle de l’insuline ne s’est pas faite à un moment précis et représente l’aboutissement de plusieurs années de recherche. On peut même dire que c’est par hasard que « la découverte » est venue du Canada. En outre, la rapidité avec laquelle s’est faite cette découverte est à souligner.
 |
Figure 1 Extrait des Comptes rendus de la Société de Biologie, vol. 85, 1921. |
 |
Figure 2 Séance de la Société de biologie du 23 décembre 1922, Eugène Gley demande l’ouverture d’un pli cacheté qu’il avait adressé en février 1905. Permission de la Société de biologie. |
La « découverte » à Toronto
En effet, cette découverte, au cours des années 1921 et 1922, est celle d’une équipe de Toronto dirigée par un spécialiste des hydrates de carbone, John MacLeod, et de Frederick Banting, Charles Best, et James Collip. Frederick Banting est né en 1891 dans une ferme près de Toronto. Médecin orthopédique, il pratique la chirurgie d’urgence pendant la Première Guerre mondiale dans un hôpital derrière les tranchées près de Cambrai en 1918. Blessé par un éclat d’obus, il rentre au Canada en 1919 et, ne trouvant pas de poste à l’hôpital de Toronto, décide de s’installer en privé à London (Ontario) où il travaille également à temps partiel comme enseignant à l’Université de Western Ontario.
Le 30 novembre 1920, Banting doit donner un cours sur le métabolisme des hydrates de carbone. Il se plonge dans la lecture d'un article de revue dans Surgery, Gynecology et Obstetrics de Moses Barron, pathologiste américain de l'Université du Minnesota sur les relations entre les îlots de Langerhans et le diabète, qui fait un rappel des données obtenues chez l'animal et chez l’homme sur la régulation de la glycémie (Barron, 1920; Figure 3). Après son cours, fasciné par cet article, Frederick Banting demande au professeur Miller s’il peut travailler sur ce sujet dans son laboratoire à l’Université de Western Ontario. Le diabète n’étant pas son thème de recherche, Miller lui propose de s'adresser à un professeur arrivé en 1918 à l'Université de Toronto, John MacLeod (1876–1935).
Ce dernier reçoit sans grand enthousiasme ce jeune chirurgien et finit par accepter, en raison de la pugnacité de Banting, que celui-ci vienne pour un stage dans son laboratoire au cours de l'été 1921. Il lui offre la possibilité d'obtenir l'aide d'un jeune étudiant, Charles Best (1899–1978), leur proposant un petit espace de travail et douze chiens pour réaliser des ablations du pancréas.
C'est ainsi que le 17 mai 1921, Frederick Banting et Charles Best commencent à travailler ensemble. Il n’y a pas de véritable animalerie avec de bonnes conditions sanitaires pour maintenir des chiens et, au cours de l'été 1921, une chaleur torride s’abat sur Toronto. Dans ces conditions, les premiers résultats sont un échec. Au retour de John MacLeod en septembre, des discussions animées, après quelques résultats encourageants, permettent à Banting et Best de poursuivre leur travail. Banting est chargé de la chirurgie et Best de la purification d'extraits pancréatiques.
Le 14 novembre 1921 a lieu une réunion au sein du laboratoire au cours de laquelle il est décidé de s'intéresser au temps de survie des animaux après l'ablation du pancréas. Banting a l'idée d'utiliser des pancréas de veau fœtal obtenus à l'abattoir, car les enzymes de la sécrétion externe du pancréas telles que la trypsine, qui pourraient détruire la sécrétion interne, ne sont actifs pour la digestion qu'à partir de la naissance. En utilisant de l'alcool et de l'acide, Best et MacLeod apportent une amélioration dans la préparation en extraits plus actifs mais pas encore suffisamment purifiés. Cependant, même dans ces conditions, en un mois, des résultats probants sont obtenus, montrant qu'un chien devenu diabétique par ablation du pancréas peut survivre plusieurs semaines lorsque des extraits pancréatiques purifiés de veau fœtal, puis de bœuf, sont administrés. Il n’est donc plus nécessaire de bloquer la sécrétion externe du pancréas pour que l’insuline puisse agir. C’est une avancée fondamentale dans les travaux de l’équipe canadienne (Banting & Best, 1922).
C'est aussi à cette période qu'arrive dans le laboratoire un biochimiste renommé, James Collip (1892–1965) pour effectuer une année sabbatique. Son apport à la découverte de l'insuline va être considérable. Il met en place des tests chez le lapin pour évaluer l'efficacité des extraits (Banting et al., 1922a), la mesure du glycogène dans le foie et la combustion des hydrates de carbone, développe de nouvelles méthodes pour mesurer le glucose et surtout ses compétences en biochimie permettent une amélioration considérable dans la purification et l'efficacité des extraits pancréatiques (Best & Scott, 1923; Collip, 1924).
Les premiers résultats sont présentés au Congrès de la Société américaine de physiologie le 30 décembre 1921. Début janvier 1922, soit huit mois après le début de leurs travaux, des extraits de pancréas de bœuf préparés par Charles Best sont utilisés chez un enfant de 13 ans, Léonard Thompson, souffrant de diabète de type 1 et qui n’a plus que quelques jours à vivre (Figure 4). Malgré une réduction de la glycémie de 25 %, les résultats sur les autres paramètres, comme la cétonurie ou le métabolisme, sont décevants. MacLeod demande donc à Collip de préparer de nouveaux extraits en utilisant une autre méthode d’extraction par évaporation de l’alcool. Cette décision va naturellement avoir des conséquences sur les relations dans le laboratoire, en particulier entre Banting et MacLeod. Dès le 23 janvier, ces nouveaux extraits sont administrés au petit garçon et des résultats spectaculaires sont obtenus. Avec la purification réalisée par Collip, Léonard Thompson reprend de la vigueur et tous les paramètres retournent à des taux normaux. Six autres enfants, qui, comme le jeune Thompson, survivaient sous un régime sans hydrates de carbone, sont traités avec succès par des injections sous-cutanées avec les extraits purifiés préparés par Collip (Banting et al., 1922b).
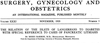 |
Figure 3 Article de Moses Barron (1920), publié dans Surg Gynecol Obstet 1920, 31,437-448, qui va donner l’envie à F. Banting de s’intéresser au diabète. Permission de l’American College of Surgeons. |
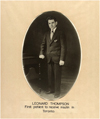 |
Figure 4 Leonard Thompson, le premier patient à avoir été traité pour son diabète par l’insuline. Non datée. Permission de la Thomas Fisher Rare Book Library, Université de Toronto. |
Les retombées de la découverte
Rapidement, la nouvelle est relayée par les médias et se propage dans le monde entier (Figure 5). Les diabétologues des plus grands hôpitaux de la planète écrivent au laboratoire de Toronto pour obtenir des extraits d’insuline. Les laboratoires Connaught, rattachés à l’Université de Toronto, mettent en place la production d’insuline pour répondre à la demande. Hélas, Collip ne peut reproduire dans les mois qui suivent la même qualité de la substance pour une fabrication massive. Ce n’est qu’en mai–juin 1922 que de nouveaux extraits sont disponibles, en premier lieu pour les États-Unis (via un brevet avec Eli Lilly) et le Canada (Bliss, 2007; Rostène & De Meyts, 2021).
À l’automne 1922, le Danois August Krogh, lauréat du Prix Nobel de Médecine en 1920, et l’Anglais Sir Henry Dale, Prix Nobel en 1936, viennent à Toronto et sont impressionnés par les résultats cliniques. Ils obtiennent des extraits pour le Danemark et l’Angleterre. C’est dans ce cadre, sous l’impulsion de Hans-Christian Hagedorn, que sera créé Nordisk puis Novo avec Thorvald Pedersen, qui deviendra en 1989 Novo Nordisk, la compagnie pharmaceutique la plus connue pour le traitement du diabète par l’insuline (Rostène & De Meyts, 2021).
Ces deux visites vont participer le 26 octobre 1923 à la nomination de Frederick Banting et de John MacLeod pour le Prix Nobel de Médecine ou Physiologie. Banting, à 32 ans, est toujours le plus jeune récipiendaire de ce prix prestigieux. À noter également que jamais, jusqu’à présent, le Prix Nobel n’a été décerné à une découverte aussi récente. Les relations tendues entre Banting et MacLeod ont bien failli faire capoter l’obtention du Prix. Leur animosité a amené Banting à partager financièrement son Prix avec Best, et MacLeod en a fait de même avec Collip. Ils ne se rendront pas à Stockholm pour recevoir leur prix et donneront séparément leur conférence Nobel en 1925 à l’Université Karolinska (Bliss, 2007).
Il y eut aussi de nombreux désaccords sur le choix de Banting et MacLeod de la part de leurs concurrents, en particulier Zuelzer et Paulesco. Il est vrai que la découverte en elle-même est une progression logique de recherches effectuées précédemment, l’équipe de Toronto n’ayant apporté sur cet aspect qu’une amélioration dans la purification des extraits. Ce qui a surtout marqué les membres du comité Nobel, ce sont les résultats cliniques, que n’avaient pas obtenus les autres équipes.
Les quatre découvreurs (Figure 6) ont connu des destins divers. Frederick Banting s’est écarté de la recherche sur l’insuline, a laissé une clinique de diabétologie à l’un de ses amis, s’est intéressé sans succès à des recherches sur le cancer et est devenu Président du comité pour la recherche biomédicale au Centre national de la recherche du Canada. C’est dans ce cadre que, au cours d’une mission en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, le bombardier dans lequel il a pris place s’écrase à Terre-Neuve le 21 février 1941. Banting aura droit à des obsèques nationales. John MacLeod, malade, retournera en Écosse où il décède en mars 1935 à l’âge de 59 ans. James Collip, quant à lui, bien qu’ayant abandonné l’insuline, va poursuivre une brillante carrière en endocrinologie. On lui doit principalement l’isolation de l’hormone parathyroïdienne en 1925, puis la purification de la TSH en 1933 et de l’ACTH en 1940. En 1930, il isole deux œstrogènes, l’emmenin et le premarin, qui seront utilisés pendant des années dans le traitement substitutif de la ménopause (Collip, 1930). Il décède en 1965. Charles Best enfin, le plus jeune, mènera lui aussi une brillante carrière scientifique. On lui doit la découverte de deux messagers de la transmission nerveuse, la choline et l’histamine, et pendant la guerre celle d’un anticoagulant, l’héparine (Best et al., 1937). Il décède en 1978.
 |
Figure 5 Lettres reçues par l’équipe de Toronto après la découverte de l’insuline pour des remerciements ou pour obtenir cette hormone. © Postes Canada et heritage.utoronto/exhibits/insulin. |
 |
Figure 6 Les quatre « découvreurs » de l’insuline. Permission de la Thomas Fisher Rare Book Library, Université de Toronto. |
Les grandes étapes scientifiques depuis la découverte
Rarement, sauf peut-être pour les vaccins contre le VIH ou le Sars-Cov-2 pendant cette pandémie de 2020–2021, un traitement pour une pathologie a été attendu comme celui du diabète qui menait, jusqu’au début du xxe siècle, à une mort certaine. L’insuline reste le traitement pharmacologique du diabète, en particulier de type 1. La découverte de l’insuline a fait l’objet d’avancées majeures sur le plan scientifique, concrétisées par quatre Prix Nobel. Première protéine cristallisée par John Abel en 1926, première protéine séquencée en 1955 par Frederick Sanger, première protéine synthétisée en 1963–1965, première hormone à être mesurée par dosage radio-immunologique dans le sang par Salomon Berson et Rosalyn Yalow et, enfin, la première protéine à être fabriquée en 1979 par génie génétique à partir d’ADN recombinant (Rostène & De Meyts, 2021). Le récepteur de l’insuline a été caractérisé et amplement étudié à partir de 1970–1971 (voir l’article de P. De Meyts dans ce numéro). De très nombreuses publications (près de 440 000 répertoriées fin 2021 dans PubMed) montrent que l’insuline a de multiples effets. Parmi ces articles, plusieurs ont été publiés en 2021 afin de commémorer le 100e anniversaire de sa découverte (Rostène & De Meyts, 2021).
Conclusion
Le diabète reste un enjeu de santé publique. De 150 millions de diabétiques recensés dans le monde en 2000, le nombre est estimé de nos jours à 540 millions et à près de 640 millions en 2030 ( International Diabetes Federation Atlas, ed. 2021). De nombreux progrès ont été réalisés depuis la découverte de l’insuline dans la prise en charge du diabète et l’amélioration des conditions de vie des diabétiques. L’insuline reste à la base de nombreuses innovations et son utilisation fait l’objet de plusieurs développements technologiques et pharmacologiques (voir l’article de Sophie Borot dans ce numéro).
Références
- Banting, F.G., Best, C.H. (1922). The internal secretion of the pancreas. J Lab Clin Med, 7, 256–271. [Google Scholar]
- Banting, F.G., Best, C.H., Collip, J.B., MacLeod, J.J.R., Noble, E.C. (1922a). The effects of pancreatic extract (insulin) on normal rabbits. Am J Physiol, 62, 162–176. [CrossRef] [Google Scholar]
- Banting, F.G., Best, C.H., Collip, J.B., Campbell, W.R., Fletcher, A.A. (1922b). Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus. Can Med Assoc J, 12, 141–146. [PubMed] [Google Scholar]
- Barron, M. (1920). The relation of the islets of Langerhans to diabetes with special reference to cases of pancreatic lithiasis. Surg Gynecol Obstet, 31, 437–448. [Google Scholar]
- Bernard, C. (1867). Nouvelles recherches expérimentales sur les phénomènes glycogéniques du foie. CR Soc Biol, 9, 1–7. [Google Scholar]
- Best, C.H., Scott, D.A. (1923). The preparation of insulin. J Biol Chem, 23, 709–722. [CrossRef] [Google Scholar]
- Best, C.H., Cowan, C., MacLean, D.L. (1937). Heparin and the formation of white thrombi. Science, 85, 338–339. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Bliss, M. (2007). The discovery of insulin. 25th anniversary. The University of Toronto Press (ed). Centenary the University of Toronto Press ed, 2021, pp. 1–304. [Google Scholar]
- Collip, J.B. (1924). Some recent advances in endocrinology. Can Med Assoc J, 14, 812–820. [Google Scholar]
- Collip, J.B. (1930). Placental hormones. Br Med J, 2, 1080–1081. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- De Meyer J. (1909). Action de la sécrétion interne du pancréas sur différents organes et en particulier sur la sécrétion rénale. Arch Physiol, 7, 96–99. [Google Scholar]
- Gley, E. (1922). Action des extraits de pancréas sclérosé sur des chiens diabétiques. C R Soc Biol, 87, 1322–1325. [Google Scholar]
- International Diabetes Federation Atlas, ed. (2021). 10th ed., Bruxelles, Belgique. https://www.diabeteatlas.org. [Google Scholar]
- Kleiner, I.S. (1919). The action of intravenous injections of pancreas emulsions in experimental diabetes. J Biol Chem, 40, 153–178. [CrossRef] [Google Scholar]
- Laguesse, E. (1893). Sur la formation des îlots de Langerhans dans le pancréas. C R Soc Biol, 5, 819–820. [Google Scholar]
- Murlin, J.R., Clough, H.D., Gibbs, C.B.F., Stokes, A.M. (1923). Aqueous extracts of the pancreas. 1. Influence on the carbohydrate metabolism of depancreatized animals. J Biol Chem, 56, 253–296. [CrossRef] [Google Scholar]
- Paulesco, N.C. (1921). Influence du laps de temps écoulé depuis l’injection intraveineuse de l’extrait pancréatique chez un animal diabétique. C R Soc Biol, 85, 558. [Google Scholar]
- Rostène, W., De Meyts, P. (2021). Insulin: a 100-year-old discovery with a fascinating history. Endocr Rev, 42, 503–527. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Scott, E. (1912). On the influence of intravenous injections of an extract of the pancreas on experimental pancreatic diabetes. Am J Physiol, 29, 306–310. [CrossRef] [Google Scholar]
- Von Mering, J., Minkowski, O. (1889). Diabetes mellitus nach Pankreasextirpation. Zentralbl Klin Med, 10, 394–395. [Google Scholar]
- Zuelzer, G. (1912). Pancreas preparation suitable for the treatment of diabetes. US Patent Office, May 28, No. 431.226. [Google Scholar]
Citation de l’article: Rostène, W. (2022). La découverte de l’insuline 1921–1922: un saut dans la recherche biomédicale. Biologie Aujourd’hui, 216, 1-6
Liste des figures
 |
Figure 1 Extrait des Comptes rendus de la Société de Biologie, vol. 85, 1921. |
| Dans le texte | |
 |
Figure 2 Séance de la Société de biologie du 23 décembre 1922, Eugène Gley demande l’ouverture d’un pli cacheté qu’il avait adressé en février 1905. Permission de la Société de biologie. |
| Dans le texte | |
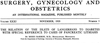 |
Figure 3 Article de Moses Barron (1920), publié dans Surg Gynecol Obstet 1920, 31,437-448, qui va donner l’envie à F. Banting de s’intéresser au diabète. Permission de l’American College of Surgeons. |
| Dans le texte | |
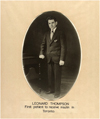 |
Figure 4 Leonard Thompson, le premier patient à avoir été traité pour son diabète par l’insuline. Non datée. Permission de la Thomas Fisher Rare Book Library, Université de Toronto. |
| Dans le texte | |
 |
Figure 5 Lettres reçues par l’équipe de Toronto après la découverte de l’insuline pour des remerciements ou pour obtenir cette hormone. © Postes Canada et heritage.utoronto/exhibits/insulin. |
| Dans le texte | |
 |
Figure 6 Les quatre « découvreurs » de l’insuline. Permission de la Thomas Fisher Rare Book Library, Université de Toronto. |
| Dans le texte | |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.


